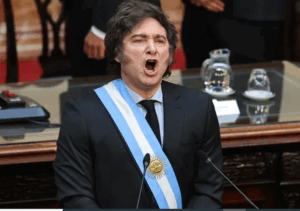Entre l’inertie de la vieille garde et la désaffection d’une jeunesse connectée, la démocratie marocaine cherche désespérément un respirateur. Le dernier Conseil des ministres, en adoptant une réforme électorale qui accorde un élan sans précédent aux candidats de moins de 35 ans pour 2026, reconnaît la fatigue du système et l’« abîme existentiel » entre les générations. L’intention est noble, celle de renouveler l’air vicié d’une classe politique retranchée. Cependant, se référant à la sagesse caustique de George Bernard Shaw, cette chronique éditoriale souligne le risque que le financement et la simplification n’achètent pas la conviction. Pour que cette réforme soit un acte d’« hygiène démocratique » et non un simple ravalement de façade, les jeunes devront franchir le seuil avec audace et éviter à tout prix le mimétisme de leurs prédécesseurs.
« Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent… et pour les mêmes raisons ». La phrase, attribuée à George Bernard Shaw, conserve toute sa vigueur. Sous la légèreté de l’ironie se cache une leçon de morale publique : tout pouvoir qui dure trop longtemps se corrompt, comme l’air qui s’épuise dans une pièce sans fenêtres. L’humour de Shaw, à la fois cruel et salutaire, agit ici comme un désinfectant politique : il rappelle que la démocratie, pour rester vivante, doit respirer.
Dans le paysage marocain, certaines figures semblent s’être incrustées dans le décor. Ministres, parlementaires ou chefs de partis — l’un d’eux, récemment réélu pour la quatrième fois consécutive — s’accrochent à leur fauteuil comme à un droit héréditaire. On ne sait plus si l’expérience est devenue sagesse ou simple habitude. Les visages changent parfois, mais les réflexes demeurent : clientélisme, immobilisme, promesses recyclées. La politique devient gestion comptable du temps, non espace d’imagination collective. On ne gouverne plus pour transformer, on administre pour durer.
Et pourtant, le pays change. Une société jeune, urbaine, connectée et instruite, regarde ce théâtre avec une distance croissante. Beaucoup n’attendent plus rien de la classe politique. Ils s’informent ailleurs, débattent ailleurs, espèrent autrement. L’écart entre les générations n’est plus idéologique, il est existentiel.
C’est précisément pour briser cette inertie que le dernier Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi, a adopté une réforme électorale inédite. L’objectif : favoriser la participation des jeunes de moins de 35 ans aux élections législatives de 2026. Les textes prévoient plusieurs mesures concrètes : un soutien financier couvrant jusqu’à 75 % des dépenses de campagne, la simplification des conditions de candidature, et la possibilité pour les jeunes de se présenter indépendamment des partis politiques.
Une volonté claire d’ouvrir la scène publique à une génération nouvelle, plus en phase avec les réalités sociales du Maroc d’aujourd’hui.
L’intention est noble, mais l’histoire politique enseigne que les réformes ne valent que par leur mise en œuvre. On peut financer la jeunesse, mais on ne subventionne pas la conviction. On peut faciliter l’accès, mais non la conscience. Si la culture politique demeure prisonnière des allégeances personnelles et des calculs d’appareil, les jeunes risquent d’être réduits à une décoration symbolique : utiles pour les affiches, invisibles après les élections.
L’humour de Shaw, s’il observait cette scène, saluerait peut-être le geste comme un effort d’hygiène. On tente enfin d’aérer une salle où les mêmes voix résonnent depuis trop longtemps. Mais il n’exclurait pas le risque d’un recyclage des postures, celui d’introduire des jeunes qui, une fois installés, s’habitueraient à l’odeur du pouvoir. Car le véritable renouvellement n’a de sens que s’il s’accompagne d’un changement de mentalité, où le service l’emporte sur le privilège, la responsabilité sur le calcul et la durée utile sur la durée vide. La démocratie marocaine s’avance, lentement mais sûrement, vers davantage de transparence et de pluralisme. Pourtant, une fatigue civique s’installe. Beaucoup de citoyens regardent la politique comme une pièce qu’ils ont trop souvent vue : mêmes rôles, mêmes acteurs, même intrigue. La jeunesse, elle, oscille entre impatience et désenchantement. On lui parle d’avenir, mais on lui laisse trop peu de place pour le construire. Les réseaux sociaux deviennent alors un exutoire, parfois un substitut à la participation réelle — une agora virtuelle où l’indignation remplace l’action.
Permettre aux jeunes de s’engager directement dans la compétition électorale représente donc un test grandeur nature. L’État ouvre la porte, mais c’est à eux de franchir le seuil avec audace, en évitant le piège du mimétisme. Le Maroc a besoin d’un souffle neuf, d’une génération qui ose bousculer les habitudes, même celles de ses propres mentors. Le pays ne manque ni d’intelligence ni de talent, mais il manque parfois de courage civique pour se réinventer.
Il faut dire que l’enjeu dépasse la simple alternance. Ce qui est en question, c’est la capacité du système à se régénérer sans se renier. La continuité institutionnelle est une force, à condition qu’elle n’étouffe pas la relève. Comme dans toute respiration, il faut un rythme où l’on inspire l’expérience et où l’on expire la routine. Changer les responsables ne signifie pas détruire, mais entretenir la vitalité d’un corps politique. Et si l’on veut éviter la sclérose, il faut accepter que le mouvement soit la seule forme durable de stabilité.
Shaw, dans sa causticité, aurait souri devant cette tentative d’hygiène démocratique. Car changer les hommes politiques n’est pas un acte de vengeance, mais de prévention. C’est une forme de santé publique, car le pouvoir, s’il n’est pas nettoyé régulièrement, contamine tout ce qu’il touche. Le véritable patriotisme consiste à comprendre que personne n’est indispensable, surtout dans un pays jeune, créatif et plein d’énergie. Être un bon dirigeant, c’est savoir partir à temps, avec élégance, en laissant le siège propre pour celui qui viendra après.
Le Maroc entre dans une phase décisive, celle d’un passage où les générations se rencontrent sans jamais se confondre. Si les réformes électorales réussissent à transformer l’intention en dynamique réelle, 2026 pourrait marquer le début d’un cycle vertueux — celui d’un État qui mise sur ses jeunes non comme symbole, mais comme force de gouvernance.
La démocratie, au fond, n’est ni un décor ni un rituel. C’est un organisme vivant qui doit se purifier pour ne pas se décomposer. Et si le pouvoir, comme les couches, doit être changé souvent, c’est pour que l’air reste respirable et la politique digne de son nom. « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », écrivait Montesquieu dans De l’esprit des lois. Il nous avait prévenus, le pouvoir n’est sain que lorsqu’il trouve sa limite. La démocratie, elle, ne survit qu’à condition d’être ventilée.